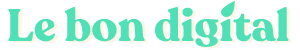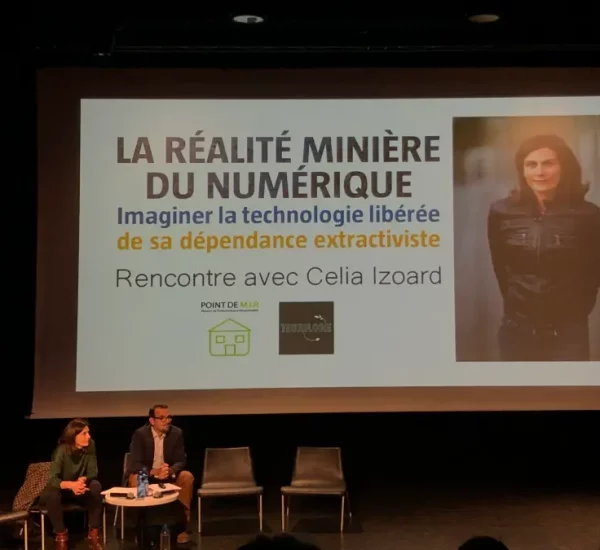À quoi devrions-nous nous attendre des technologies qui infusent de plus en plus dans notre quotidien ? On en entend parler de tous les côtés, des big techs aux artistes, des concepteurs de services numériques aux fans de réalité virtuelle.
Quand le metavers nous promet une nouvelle vie entièrement digitale, les NFTs (non-fungible tokens) prouvent l’authenticité d’un produit numérique. Déjà en place, ces nouveautés ont ouvert la curiosité de tous depuis plusieurs mois. Elles font déjà des adeptes et le volume d’échanges de NFTs pour la fin 2021 atteignait plus de 10 milliards de dollars.
Il est important de regarder ces nouvelles technologies sous des spectres encore peu trop évoqués : les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux qu’ils induisent. Essayons de démêler le vrai du faux des impacts de ces technologies.
Metavers et NFT : quels impacts environnementaux ?
NFT : des calculs gourmands
Les NFTs, comme évoqué, prouvent l’authenticité d’un produit numérique. Très à la mode dans les milieux de l’art, ils permettent la vente d’œuvres digitales authentiques. L’impact environnemental lié à cette technologie se cache dans la méthode d’authentification.
Pour prouver l’authenticité d’un produit, les NFTs utilisent la blockchain et une méthode bien connue des cryptomonnaies : le proof of work. Dans le cadre d’une demande d’authentification d’une oeuvre, les ordinateurs du réseau doivent la valider en résolvant un algorithme complexe. Le principe est le même pour la plupart des transactions de cryptomonnaies comme le Bitcoin.
Ce n’est qu’après validation que l’acheteur de NFT reçoit un jeton numérique, lui prouvant la véracité de l’œuvre achetée. Le problème ? Les calculs complexes que résolvent les ordinateurs sont très consommateurs en électricité. De plus, c’est une multitude d’ordinateurs qui sont nécessaires à la création d’un NFT. La consommation d’électricité est directement liée à l’émission de gaz à effet de serre selon sa méthode de production. Dans le cas du minage de cryptomonnaies, des fermes entières d’ordinateurs exécutant les calculs sont en majorité en Chine, là où la production d’électricité est majoritairement faite avec des centrales à charbon. Les NFTs ne seraient alors pas en reste.
Même si l’impact exact d’un NFT peut varier, certains calculs permettent d’évaluer cette pollution gargantuesque. Un article de France info indique : « La plupart des NFT sont actuellement échangés sur une plateforme appelée Ethereum. L’organisme de surveillance des technologies Digiconomist estime qu’Ethereum utilise autant d’électricité que l’ensemble des Pays-Bas, avec une empreinte carbone comparable à celle de Singapour… »
L’artiste Joanie Lemercier a également évalué que la mise en ligne de 6 cryptoarts a consommé en 10 secondes plus d’énergie que son studio entier en 2 ans.
Le métavers : l’univers entièrement digital a un coût environnemental
Nouvelle lobby de Mark Zuckerberg, le metavers aurait comme ambition de fusionner notre réalité physique et digitale. Ce monde fictif numérique entièrement modélisé en 3D est déjà en place. C’est grâce à un avatar que nous évoluons dedans. Cet univers soulève de nombreuses questions éthiques et environnementales. Benjamin Demonet, ingénieur chez fruggr, les a évoquées dans un webinaire disponible ici.
Les principaux impacts du metavers, comme pour tout les services et produits numériques, résident dans le matériel. Pour accéder à ces nouveaux services, des équipements sont nécessaire. Le minimum pour entrer dans un metavers reste un ordinateur ou un smartphone. À ceux-ci nous pouvons ajouter les casques de réalité virtuelle ainsi que les gants et combinaisons pour ressentir les interactions.
Ce monde parallèle dématérialisé induit de nombreux flux vidéos en temps réel. Nous ne pouvons pour le moment qu’imaginer ce que seront les metavers lorsqu’ils auront pris une place importante dans nos sociétés. Les utilisateurs privilégieraient des appareils plus puissants pour supporter les flux de données. L’augmentation de l’utilisation de la 4G et 5G peut aussi être évoquée, si nous tendons à inclure le metavers dans nos usages mobiles. Rappelons que ces réseaux ont un impact démultiplié face au Wifi.
Cette technologie ne peut qu’accentuer le stress sur les ressources hydriques et abiotiques induites par une multiplication de nos appareils électroniques.
Metavers : les impacts sociaux et sociétaux
Le metavers va t-il redessiner nos rapports sociaux ?
Les préoccupations sur cette nouvelle technologie sont plutôt tournées sur leurs répercussions sociales et sociétales. Comme le rappelle Benjamin dans son webinaire, de nombreuses personnes sont déjà éloignées du numérique. Une fracture numérique liée à des moyens financiers, un handicap… À cette connexion difficile, nous pouvons ajouter son opposé : l’hyperconnexion. C’est un sujet déjà répandu et notamment avec une connexion de plus en plus tôt. Si le metavers se développe dans les prochaines années, une génération entière pourra grandir au rythme de ce monde digital.
Cette hyperconnexion généralisée pourra modifier notre rapport aux autres. On peut y voir, dans un cas extrême, un remake de Clones, un film SF de Jonathan Mostow : « L’énorme majorité de la population pilote une version robotisée d’elle-même, actionnée mentalement. Pour éviter de se montrer en public, ces personnes se servent de leur « clone » pour tout faire à leur place : elles sont ainsi en grande partie immunisées contre les désagréments de la vie. » (synopsis disponible sur Wikipédia). Est-ce que le metavers pourrait effriter nos relations dans la vie réelle ? Le vivre-ensemble en serait-il modifié ? Des questions n’ayant pour l’heure pas de réponses concrètes, seul l’avenir nous le dira.
Metavers et souveraineté de nos données
Enfin, quid de la souveraineté de nos données dans ce nouvel espace numérique ? En effet, un des metavers les plus connus aujourd’hui reste celui de Meta, entreprise mère de Facebook, Instagram ou encore Whatsapp. Les big techs comme celles-ci sont connues pour collecter une quantité astronomique de données sur nous, nos habitudes et modes de vie. J’en parle plus en détail dans cet article dédié. Les enjeux commerciaux les incitent à courir après cet or pixelisé que chaque individu créé sur le numérique. Dans un metavers qui a l’ambition d’être un monde parallèle entièrement numérique, les possibilités de création et de collecte de données sont infinies (tracking de notre regard, de nos mouvements…). Cette production et de nouvelles données par chaque utilisateur viendra nourrir le tracking et les ambitions commerciales déjà discutables des plus grands.
NFTs et metavers : des impacts positifs ou solutions ?
Des impacts positifs pour les NFTs ?
Cependant, ces technologies sont à prendre en entier, et elles peuvent aussi avoir des impacts plus positifs. Les NFTs ont notamment permis une meilleure rémunération des artistes. Dans le même article FranceInfo, l’article vonMash explique : « Si quelqu’un d’autre achète mon NFT, je reçois automatiquement une part de cette somme ». Une meilleure valorisation du travail des artistes.
Comme pour les cryptomonnaies, des alternatives aux méthodes de calculs énergivores sont déjà exploitées. Sur les NFTs, des méthodes d’authenfication différentes au classique proof of work pourrait être moins énergivores. Pour le moment, certains existent pour les cryptomonnaies mais pas d’avancées côté NFT.
Peut-on concevoir de manière « plus responsable » un metavers ?
Ce sujet meriterait un article en lui-même. Comme pour tout service numérique, il est bien évidemment possible de designer et développer un metavers « plus responsable » que celui de notre cher Mark. Côté design de l’expérience utilisateur, il sera central de limiter le design d’attention et de rendre le metavers le plus accessible possible. Côté technique, privilégions l’open source et un service utilisable sur le maximum d’appareils possibles.
Mais la question devrait résider dans l’existence-même d’un nouveau metavers. Quelle serait son utilité ? Sera-t-il utilisé ou deviendra-t-il un énième projet numérique lancé sans grand retour ?
A propos de l'auteur
Alizée Colin
Fondatrice & rédactrice
UX/UI designeuse, j’aspire à recentrer le web et ses outils dans un objectif de bien commun, tant bien environnemental que social. Nous sommes dans une ère où nous nous devons de réinventer notre manière de concevoir et de communiquer. Le numérique responsable en fait partie. Changeons les choses.
Voir tous les articles